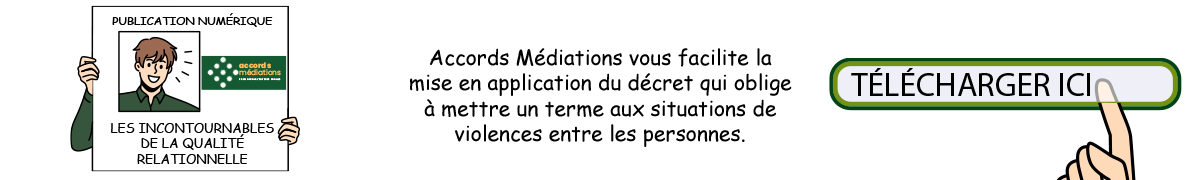de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.
Députés, sénateurs, maires : tous décrivent la même fatigue démocratique. À l’heure où la coopération recule, où les conflits internes explosent, un mot revient en creux : dialogue. Mais peut-on encore (ré)apprendre à faire ensemble ?
Les interviews croisées de Marion Canales, sénatrice, et d’André Chassaigne, ancien député, faisaient entendre une voix rare dans le paysage politique actuel : celle d’élus convaincus que le dialogue transpartisan, l’écoute active et la recherche du compromis ne sont pas des signes de faiblesse, mais des piliers indispensables du débat démocratique.
Pourtant, ce souffle de dialogue semble aujourd’hui de plus en plus étouffé. Au Parlement, d’abord, où le face-à-face politique vire trop souvent à la joute verbale. Mais aussi, et peut-être surtout, dans la vie démocratique locale, où une enquête récente du CEVIPOF pour l’Association des maires de France (AMF) révèle un phénomène inquiétant : un nombre record de maires démissionnent, épuisés par les tensions internes à leur conseil municipal. Et si ce que ces deux réalités ont en commun, c’était une même crise de la qualité relationnelle ?
🚀 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.
Je m'inscris !Le dialogue politique est encore possible… et vital
Dans les entretiens qu’ils nous ont accordés, Marion Canales et André Chassaigne témoignent tous deux de leur attachement au débat démocratique. Pas celui du clash ni de la communication, mais celui qui cherche à convaincre, à faire évoluer les positions, à construire du commun même entre adversaires politiques. “Lorsque je suis arrivé à l’Assemblée, en 2002, le débat parlementaire s’appuyait sur une véritable culture de la parole argumentée” raconte ainsi André Chassaigne, qui se souvient des discussions dans les couloirs, des échanges directs avec les ministres, parfois tendus, mais où l’objectif restait de faire progresser la loi. De son côté, Marion Canales parle de “compromis” et d’un travail parlementaire qui, lorsqu’il s’en donne les moyens, peut vraiment faire avancer les choses.
Tous deux décrivent pourtant un glissement inquiétant. Le débat s’est durci. “Le dialogue, regrette André Chassaigne, a commencé à se rigidifier et la volonté de garder la main sur les textes s’est renforcée.” La tentation du coup d’éclat médiatique prend souvent le pas sur le travail de fond. Et avec cette perte de qualité relationnelle, c’est l’efficacité même du travail législatif qui en pâtit. La sénatrice Marion Canales s’inquiète même d’une “forme de détournement du rôle du Sénat” lorsque des “propositions de loi sont défendues par des collègues qui savent pertinemment qu’elles sont inconstitutionnelles, juste pour envoyer “un signal” à la population.”
La démocratie locale, fragilisée de l’intérieur
Mais le malaise n’est pas réservé aux seules travées des Palais Bourbon ou du Luxembourg. Une enquête publiée en juin 2025 par le CEVIPOF à la demande de l’AMF met en lumière un phénomène jusqu’ici peu médiatisé : depuis juillet 2020, 2 189 maires ont démissionné de leur mandat, dont un nombre record en 2023 (613 démissions). À ce rythme, la France aura vu le nombre annuel moyen de démissions quadrupler en l’espace de trois mandats municipaux.
Le plus frappant dans cette étude ? La première cause de ces départs. Ce n’est ni la surcharge de travail ni le désengagement des citoyens, mais bien les tensions internes au sein des conseils municipaux. Dans 31 % des cas recensés, les différends, conflits ou désaccords entre élus – le plus souvent entre membres de la majorité elle-même – rendent l’exercice du mandat invivable. Les raisons invoquées sont parfois liées au fond des décisions (urbanisme, travaux, priorités budgétaires), parfois à la forme (méthode de délibération, rythme de travail), mais elles révèlent surtout des relations interpersonnelles mises à mal dans des contextes de proximité, voire de promiscuité. Dans les petites communes, on ne se croise pas seulement au conseil municipal. On se connaît, on se voit, on se juge… parfois depuis des années. Et lorsque le dialogue est rompu, c’est tout un tissu social qui se déchire.
La qualité relationnelle : un angle mort… et une solution
Ce que révèlent ces deux niveaux d’analyse c’est une même fragilité structurelle : l’incapacité croissante de nos institutions à gérer le conflit autrement que par l’affrontement ou la rupture. Et si cette difficulté à débattre, à décider ensemble malgré les désaccords, n’était pas tant politique qu’humaine ? C’est là que la médiation professionnelle peut ouvrir une piste concrète. Fondée sur une approche rigoureuse des dynamiques relationnelles, elle permet d’accompagner les collectifs – élus compris – dans la gestion constructive de leurs différends. Ce qu’elle vise ? Ce n’est pas le consensus à tout prix, mais la restauration d’un cadre de dialogue, où chacun peut s’exprimer, être entendu, et contribuer à une décision légitime… même si elle ne fait pas l’unanimité !
Aussi, des médiateurs professionnels pourraient-ils intervenir dans les conseils municipaux et ce, dès l’apparition de tensions, pour éviter qu’elles ne deviennent des blocages. Quant au Parlement ? La médiation pourrait inspirer une autre manière de débattre : moins performative, plus féconde. Partout, elle rappellerait cette vérité simple et, pourtant, bien trop souvent oubliée : le conflit est inévitable, ce qui compte, c’est la manière dont on l’affronte.
Restaurer la démocratie par le lien
De l’Assemblée nationale aux mairies de nos villages, la démocratie ne tient pas uniquement à la solidité de ses institutions. Elle tient à la capacité de ses acteurs à se parler, à se confronter sans se disqualifier, à faire société malgré les divergences. Encore faut-il outiller celles et ceux qui construisent la démocratie à hauteur d’hommes. Sans prétendre tout résoudre, la médiation professionnelle rappelle, avec force, que le bien vivre ensemble ne peut se construire sans une culture du dialogue et de la relation. Elle agit là où les relations humaines dérapent, s’épuisent ou se crispent notamment dans ces lieux de proximité que sont les conseils municipaux.
Car le fait que de plus en plus de maires jettent l’éponge en cours de mandat envoie un signal préoccupant à la société : celui d’un engagement devenu ingrat, difficile, parfois même dangereux. Ce constat dissuade des vocations, assèche le débat démocratique local et altère le lien de confiance entre citoyens et institutions. À un an des municipales, il apparaît donc urgent de prendre au sérieux cette vague silencieuse de démissions. Elle ne doit pas éroder la force d’un fait unique au monde : près d’un Français sur cinquante accepte, tous les six ans, de s’engager sur une liste municipale. Cet engagement, précieux mais fragile, mérite qu’on en prenne soin. Et cela commence, peut-être, par un geste simple : apprendre à se reparler autrement.
Marianne FOUGÈRE
Plume indépendante et vagabonde
Pour en savoir plus sur l’enquête du CEVIPOF, lire la note de Martial Foucault, “Les démissions de maires : enquête sur un phénomène sans précédent”, juin 2025.
Dans sa note, Martial Foucault insiste sur les dissensions au sein des conseils municipaux, dissensions qui pourraient être, sinon évitées, du moins atténuées grâce à la formation des élus comme celle proposée par Accords Médiations.