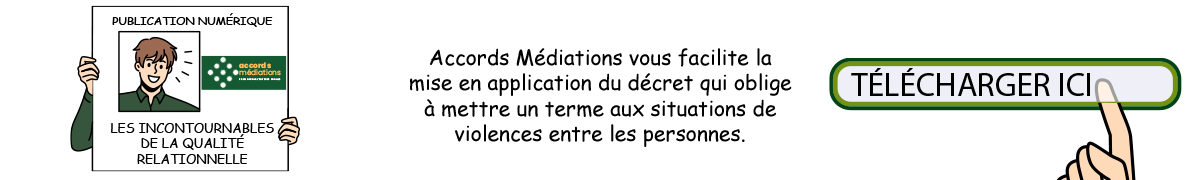de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.
Des rapports sociaux aux arènes politiques, la tendance est à la surenchère. Et si, à l’exagération, l’on préférait enfin la résolution de nos conflits ?
Des discours du ministre de l’Intérieur aux gros titres de journaux, des colloques universitaires aux conversations de comptoir : depuis quelques années, le mot radicalité et ses dérivés sont sur toutes les lèvres. Des djihadistes aux militants écologistes, du mouvement contre la réforme sur les retraites, en passant par la cuisine de ce grand chef ou l’œuvre de cette immense réalisatrice : tous, dit-on, se sont ou devraient être radicalisés. Il faut également revoir radicalement notre rapport au travail ; quant à l’intégrité de la France, elle est menacée par une vague sans précédent de radicalisations.
La radicalité est donc tendance, mais son succès ne met pas à l’abri de certaines confusions. Mieux, l’équivoque est commode car elle autorise de nombreuses réductions. Tel un verdict ou une condamnation, radicalisé permet de regrouper pêle-mêle tous ceux qui s’écartent un tantinet soit peu du droit chemin. Radicalisation ferme la porte à toute possibilité de discussion ou de négociation.
🚀 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.
Je m'inscris !Le conflit n’est pas une agression
Inquiétante, cette “confiscation1” du mot radicalité l’est car elle s’inscrit dans un mouvement plus général. Celui d’une confusion sémantique, tout aussi délétère, qui nous conduit à transformer, comme par magie, toute situation de conflit en agression. Des exemples ? Nous pourrions en citer des dizaines. Des réseaux sociaux à la sphère intime, en passant par la scène politique et les tribunes médiatiques : dans ces espaces se distribuent désormais les rôles de victimes et d’agresseur·se·s. Une mise en scène quotidienne qui nous rend de plus en plus incapables d’affronter nos conflits et nos divergences sans céder à la violence, sans entrer dans une logique d’escalade mortifère.
Au cœur de cette surenchère permanente deux dynamiques : l’une liée à une position de domination, l’autre à un traumatisme. Selon Sarah Schulman, l’une et l’autre participent à “transformer une réaction excessive au conflit en tragédie2”. Prenons l’exemple d’une cheffe d’entreprise qui estimerait ne jamais voir sa stratégie remise en question. On imagine aisément qu’elle puisse se sentir agressée si un collaborateur osait exprimer sa différence. Cette dernière est tout aussi problématique lorsque vous avez vécu un traumatisme. Pourquoi ? Car, incarnée par l’autre, elle peut s’avérer difficile à gérer émotionnellement et donc être, elle aussi, perçue comme une menace. Dans l’un et l’autre cas, les situations de conflit se retrouvent confisquées au prétexte qu’elles sont des agressions. Le résultat de ce tour de passe-passe ? Il nous positionne en victimes irréprochables. Il nous absout d’avoir à assumer nos responsabilités. Pire, il pourrait justifier le fait de nous voir vengé…
Au cœur du conflit : les différences
Il témoigne surtout de notre résistance à changer la manière dont nous nous considérons nous-même, de notre tendance à réagir de manière excessive à la différence. Le problème ? Les gens sont différents et il y a fort à parier qu’ils le resteront encore longtemps ! “Par conséquent, la manière dont nous envisageons le conflit, dont nous y répondons et dont nous nous comportons en tant que témoins est déterminante pour pouvoir vivre – ou pas – dans une situation de paix et de justice collective2.” Selon cette approche, une pensée de la justice et du vivre-ensemble impose non pas de minimiser les différences des citoyens mais, au contraire, de redonner aux désaccords et aux conflits une place centrale dans le débat politique, dans le débat tout court.
Certains d’entre nous pourraient se sentir mal à l’aise face à ce qui s’apparente ni plus ni moins à un appel à la revalorisation du conflit. Après tout, libre à chacun de préférer à la “mésentente” d’un Jacques Rancière3 le “consensus” d’un John Rawls4. Mais, dans son livre, Sarah Schulman montre combien nous aurions tort de balayer d’un revers de la main hâtif toute pensée du conflit et, surtout, pourquoi nous ne saurions laisser à d’autres le soin de s’occuper de nos conflits pour nous. En témoignent les violences intrafamiliales. Bien sûr, on ne peut que se réjouir que les mentalités changent, que la société n’accepte plus guère les situations de maltraitance et demande aux pouvoirs publics et policiers d’intervenir. Mais, nous prévient Sarah Schulman, “ce pouvoir donné à la police de ‘stopper la violence’ produit une crise de sens. Car la police est souvent la source de violences2”. Car, aux États-Unis, les policiers sont davantage impliqués dans des cas de violences sexistes et intrafamiliales… Plus largement, l’autrice nous met en garde contre l’intrusion toujours plus grande des systèmes judiciaires et policiers dans nos vies intimes et nos rapports interpersonnels. Elle nous encourage à nous réapproprier la compréhension que nous avons de nous-mêmes et des autres.
Vers une possible résolution
Comment ? En ne tombant plus dans le piège des catégorisations fallacieuses. En ne transformant plus toute situation de conflit en “agression” ou en “abus”. Sarah Schulman ne nous invite pas pour autant à gérer le conflit mais à le résoudre. “‘Résoudre’, explique-t-elle, ne revient pas à satisfaire tout le monde2”. Cela consiste plutôt “à passer de la construction coupable/victime, qui repose sur un schéma agressé·e/agresseur·se, à la reconnaissance, plus réaliste, de l’implication de plusieurs parties en désaccord, chacune exprimant des inquiétudes et des droits légitimes qui doivent être pris en compte pour aboutir à une résolution juste2”.
L’autrice propose des alternatives à l’escalade. Leur point commun ? Ces systèmes et mouvements recommandent tous la même stratégie : “prendre son temps, temporiser2”. Surtout, ils “partagent l’idée qu’il est nécessaire d’être entouré·e par une communauté : une relation, un cercle amical, une famille, une identité de groupe, une nation ou des gens qui encouragent la réflexivité et cherchent des alternatives à l’accusation, à la punition et à l’agression2”. Ils rappellent combien nous avons tous besoin les uns les autres de nouer des relations de qualité avec des personnes, des groupes, des collectifs de travail, des équipes qui “acceptent de se trouver dans l’inconfort et de prendre le temps d’aborder des événements, de prendre toutes les parties en considération et de faciliter la réparation2”. Ce à quoi la médiation professionnelle peut elle aussi nous aider.
Marianne Fougère
Plume vagabonde et indépendante
1 Marie José Mondzain, Confiscation. Des mots, des images et du temps, Paris, Les liens qui libèrent, 2017.
2 Sarah Schulman, Le conflit n’est pas une agression, Paris, B42, 2021.
3 Jacques Rancière, La Mésentente. Philosophie et Politique, Paris, Galilée, 1995.
4 John Rawls, Théorie de la justice, Paris, Seuil, coll. Points essais, 2009.