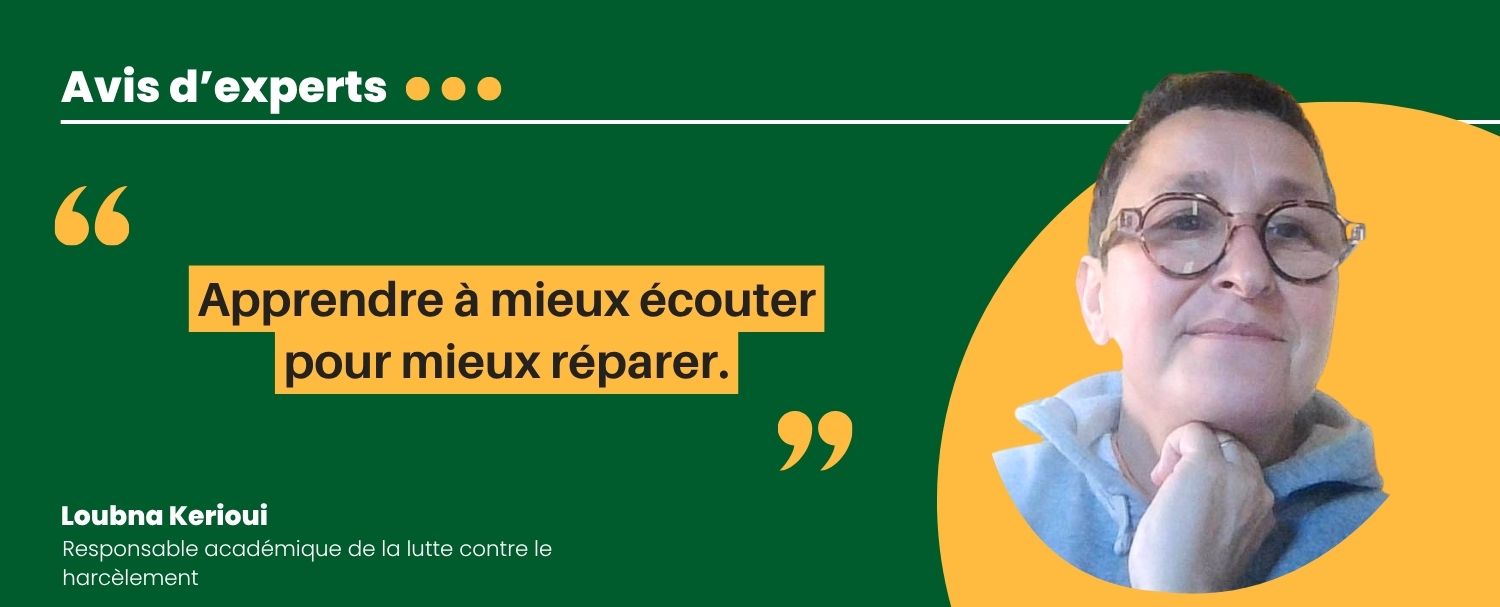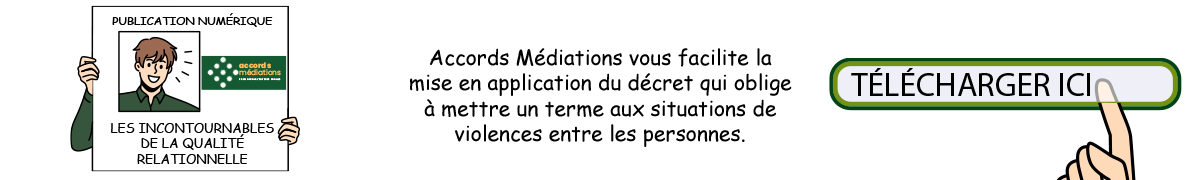de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.
En première ligne de la lutte contre le harcèlement dans l’académie de Grenoble, Loubna Kerioui défend une école fondée sur la qualité relationnelle.
Accords Médiations. Vous êtes responsable académique de la lutte contre le harcèlement. En quoi consiste exactement votre mission ?
Loubna Kerioui. J’ai trois grands axes de travail : d’abord, piloter et coordonner les équipes départementales, ensuite déployer le programme ministériel pHARe, et enfin concevoir l’ingénierie de formation destinée à nos formateurs et à mon équipe. Pris ensemble, tous convergent vers un même objectif : améliorer le climat scolaire pour traiter et prévenir les situations de harcèlement avant qu’elles ne s’enkystent.
🚀 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.
Je m'inscris !Justement, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le dispositif pHARe ?
pHARe repose sur trois niveaux de labellisation. Le niveau 2 approfondit les mesures prises au niveau 1, obligatoire, le niveau 3 vise une certaine expertise. Mais pour en revenir au niveau 1, il demande à chaque établissement de créer une équipe ressource adulte et une équipe ambassadeurs élèves. Les équipes adultes sont formées notamment pour décliner le protocole national de traitement des situations. L’une des méthodes employées est celle de la préoccupation partagée. Elle commence toujours par l’écoute de la victime et une information claire à destination des parents. Ensuite, l’équipe rencontre de manière informelle les élèves auteurs et les témoins. L’idée, c’est de faire émerger une prise de conscience : amener chacun à reconnaître qu’un élève va mal et réfléchir à la façon dont tous peuvent contribuer à apaiser la situation. C’est une approche fine, non culpabilisante, qui fonctionne très bien sauf, bien sûr, lorsque la situation est déjà trop enkystée, installée depuis longtemps.
“Une situation s’enkyste quand elle a mis trop longtemps à émerger.”
Vous parlez de situations “enkystées”. Qu’est-ce que cela signifie ?
Une situation s’enkyste quand elle a mis trop longtemps à émerger. Plus elle dure, plus le rapport entre harceleur et harcelé se renforce : le premier se sent conforté dans sa position dominante, le second s’enferme dans la peur ou le repli. Et ce n’est pas toujours intentionnel. Seule une minorité d’élèves – environ 5 % – présente un profil pervers. La plupart du temps, c’est un déséquilibre relationnel qui s’installe et qu’il faut corriger.
C’est d’ailleurs en cas de gros déséquilibres que votre équipe intervient…
Exactement. Quand une situation de harcèlement nous est signalée – par une famille, un établissement ou via le 3018, la relation entre les parents et l’école est abîmée.
Les responsables départementales prennent alors contact avec les deux parties. Leur rôle, c’est d’écouter activement, de restaurer la confiance et de recréer un lien de dialogue.
Nous sommes déjà, d’une certaine manière, dans un cadre de médiation : il faut entendre chacun, comprendre où le dialogue s’est rompu, et remettre un peu d’humanité là où la tension a pris toute la place.
Cette posture demande une vraie technicité. Qu’est-ce qu’a changé votre formation à la qualité relationnelle dans votre manière d’intervenir ?
Beaucoup de choses. Cette formation nous a apporté des outils d’écoute et de structuration très précieux. Nous utilisons désormais un questionnaire type d’entretien. Il nous aide à commencer dans une posture d’écoute totale, que personnellement, j’appelle le “mode avion”, sans interpréter ni juger. Petit à petit, en restituant les paroles de nos interlocuteurs – non pas en les reformulant, mais en disant : “Ce que vous dites, c’est…” –, on les voit cheminer. Ils quittent la colère, clarifient leurs pensées, reconnaissent parfois leurs propres zones d’ombre. C’est un travail profondément altérocentré, centré sur l’autre.
“Nous sommes déjà, d’une certaine manière, dans un cadre de médiation : il faut entendre chacun, comprendre où le dialogue s’est rompu, et remettre un peu d’humanité là où la tension a pris toute la place.”
Et sur le terrain, voyez-vous déjà les effets de cette posture ?
Oui, même si nous ne sommes encore que de jeunes “padawans” ! Quand j’applique cette méthode dans une situation sensible, je vois les effets presque immédiatement : la personne s’apaise, se sent entendue, et on peut avancer ensemble. Je me dis souvent que si cette formation à la qualité relationnelle était intégrée à la formation initiale des personnels, on éviterait beaucoup de tensions ou, du moins, les conflits ne prendraient pas autant d’ampleur, une fois les adultes entrés dans l’équation…
À vous écouter, on pourrait avoir l’impression que ce sont les adultes qui font déraper les situations…
Les personnels de l’Éducation nationale sont formés, bien sûr, mais ils restent humains : quand un parent réagit violemment, beaucoup se sentent attaqués dans leur intégrité professionnelle. Or, c’est à ce moment-là que les choses s’enveniment.
En travaillant la parité d’estime entre les uns et les autres, les situations seraient, il me semble, plus simples à gérer.
“En travaillant la parité d’estime entre les uns et les autres, les situations seraient, il me semble, plus simples à gérer.”
Est-ce un axe sur lequel vous souhaitez insister ?
En tout cas, le niveau 2 du programme pHARe prévoit le développement d’ateliers de coéducation à destination des parents, et le niveau 3 la formation de parents ambassadeurs. Le premier module du futur parcours Magistère académique s’intitule d’ailleurs « Coéduquer ». Les parents sont les premiers éducateurs et nous devons construire une relation équilibrée et non descendante entre eux et l’école. Mais cela suppose du temps et une vraie volonté réciproque. L’Éducation nationale peut proposer, encore faut-il que les familles “réceptionnent la balle”.
Qu’est-ce que cette formation à la qualité relationnelle vous a appris, personnellement ?
L’importance de la rigueur et de la précision dans nos interventions. Même avec les meilleures intentions, on peut aggraver une situation si on s’y prend mal. D’où la nécessité d’un processus structuré, d’une vraie technicité relationnelle. Et cela s’acquiert avec le temps, par la pratique. C’est exigeant, mais c’est ce qui fait aussi la beauté de cette mission : apprendre à mieux écouter, pour mieux réparer.
Propos recueillis par Marianne Fougère