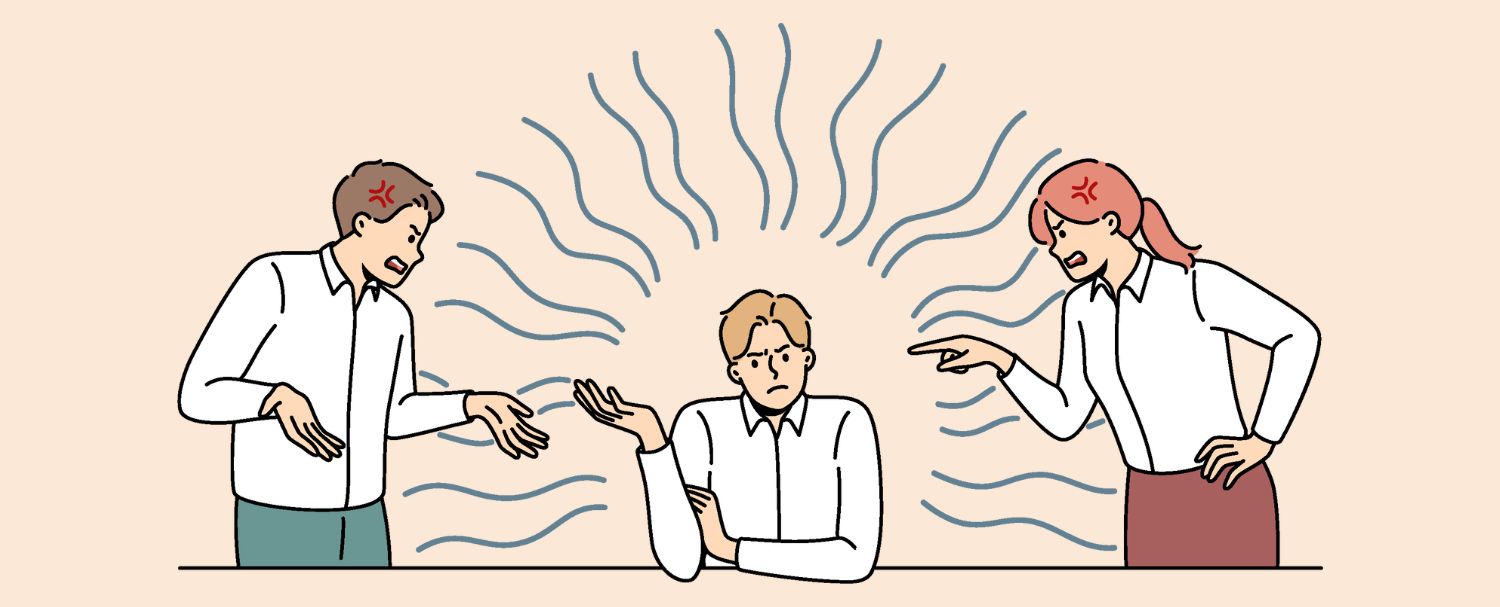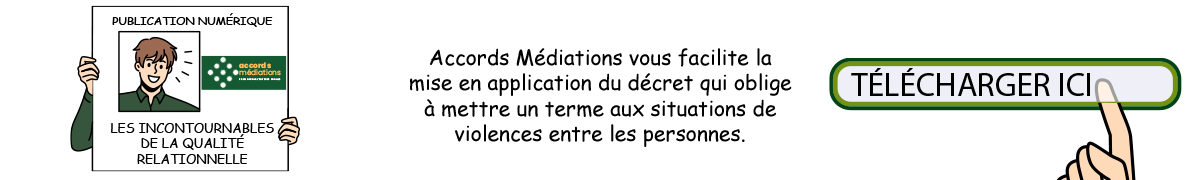de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.
En France, la confiance est devenue une denrée rare. Pourtant, le Premier ministre la réclame au Parlement ce 8 septembre. Une mission impossible ?
“Je solliciterai la confiance des parlementaires”, annonçait lors d’une conférence de presse le 25 août dernier le Premier ministre. Une formule rituelle de la vie politique, presque attendue, mais qui ne pose pas moins question : qu’est-ce que cela veut dire, au juste, demander la confiance ?
Car, jusqu’à preuve du contraire, la confiance ne se décrète pas. On peut l’appeler, la souhaiter et, pour les plus déterminés, l’exiger. Mais elle ne se donne et se vérifie que dans les actes. Elle peut naître d’un coup, comme un élan, ou se construire pas à pas. Elle peut se détériorer lentement ou se briser net. Toujours, elle s’inscrit dans le temps.
🚀 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.
Je m'inscris !Une France en mal de confiance
La France est l’un des pays d’Europe où la confiance politique est la plus fragile. Une espèce en voie de disparition. En témoigne le baromètre 2025 de la confiance politique du CEVIPOF : seuls 26 % des Français déclarent avoir confiance dans la politique, contre 47 % en Allemagne et 39 % en Italie. La défiance est encore plus marquée vis-à-vis du gouvernement (23 %), du président (23 %) ou de l’Assemblée nationale (24 %). La confiance se replie alors vers le local : 61 % des répondants disent avoir confiance en leur maire, preuve qu’une certaine forme de proximité existe encore… mais que l’écart avec les institutions nationales s’est creusé comme jamais.
À cela s’ajoute un climat psychologique dominé par les affects négatifs, ces passions tristes si craintes par Spinoza.
45 % de méfiance, 40 % de lassitude, 35 % de morosité : voilà le cocktail explosif d’une société dans laquelle la confiance devient l’exception. Seuls 13 % de nos compatriotes déclarent ressentir de la confiance*.
La fabrique de la défiance
Ce décor, Yann Algan et ses collègues l’avaient décrit dès 2012**. Leur constat ? En France, la défiance n’est pas un accident de parcours, elle est inscrite au cœur même de nos institutions et de nos pratiques sociales. Dès les bancs de l’école, les personnes sont davantage classées que rassemblées. La compétition l’emporte sur la coopération, l’angoisse sur la confiance. Et le scénario se prolonge dans les entreprises. Les salariés ont le sentiment d’être peu reconnus, mal rémunérés, mal représentés. Le dialogue social, rare et conflictuel, nourrit la suspicion.
Quant à la vie politique ? La réussite y apparaît moins liée au mérite qu’au réseau, à l’héritage qu’aux compétences, aux connivences qu’aux convictions. De quoi nourrir un soupçon permanent chez cette moitié de Français qui estime qu’ “on ne peut pas arriver au sommet sans être corrompu”. Sans parler de celles et ceux (près d’une personne sur deux) qui considèrent que les chômeurs “ne font pas vraiment d’efforts”… quand les Danois, eux, ne sont que 18 % à partager cette vision… La défiance devient alors une culture à part entière. Elle se glisse partout : dans la salle de classe, dans l’open space, dans les urnes. Elle freine la coopération, mine la solidarité, renforce l’angoisse collective, augmente notre consommation d’anxiolytiques…
C’est ce mécanisme profond qu’Algan appelle une “fabrique de la défiance” : un cercle vicieux qui abîme tout. Du civisme au dialogue social, de la performance économique au bien-être.
Un pari relationnel
C’est dans ce contexte que l’invocation de la “confiance” résonne avec autant de force… et de fragilité. L’étymologie le rappelle : confidentia, en latin, renvoie à la foi, à la croyance. Faire confiance, c’est toujours accepter une part d’incertitude, courir un risque. On peut bien décider d’accorder sa confiance, mais elle ne se prouve jamais que dans les actes.
Ce risque peut valoir le coup si l’on repère, comme le sociologue Niklas Luhmann, dans la confiance un mécanisme de réduction de la complexité sociale. Si l’on estime que la confiance fluidifie les relations, rend la vie collective plus simple, contrairement à la défiance qui complique et ralentit tout.
Il n’empêche, la confiance n’existe jamais en soi. Elle se vit dans l’expérience concrète d’une relation. Elle n’est ni une valeur abstraite, ni une obligation morale. Elle se fabrique dans l’interaction, dans la praxis sociale. Autrement dit : elle n’est pas un état stable, mais un processus. Elle ne se décrète pas, elle s’éprouve. Elle suppose de suspendre ses inquiétudes, d’accepter l’incertitude. En somme, d’oser le pari de l’autre et, surtout, de lâcher prise.
Prendre son risque
Or, c’est précisément ce qui se joue en médiation : créer les conditions où chacun peut risquer un pas de confiance, sans garantie absolue, mais avec la certitude d’un cadre protecteur. À l’heure où l’on demande la confiance dans l’arène politique, la question ne saurait donc se réduire à un vote solennel. Car la confiance touche à ce qui nous relie, à ce qui permet à une société de fonctionner sans se déchirer.
La confiance n’est jamais donnée une fois pour toutes. Elle implique un choix, fragile mais nécessaire : celui de croire qu’ensemble, malgré les incertitudes, nous pouvons avancer. Autrement. Mais vraiment.
Marianne Fougère
Plume vagabonde et indépendante
* CEVIPOF, Baromètre de la confiance politique 2025 : le grand désarroi démocratique, février 2025.
** Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg, La Fabrique de la défiance, Albin Michel, 2012.