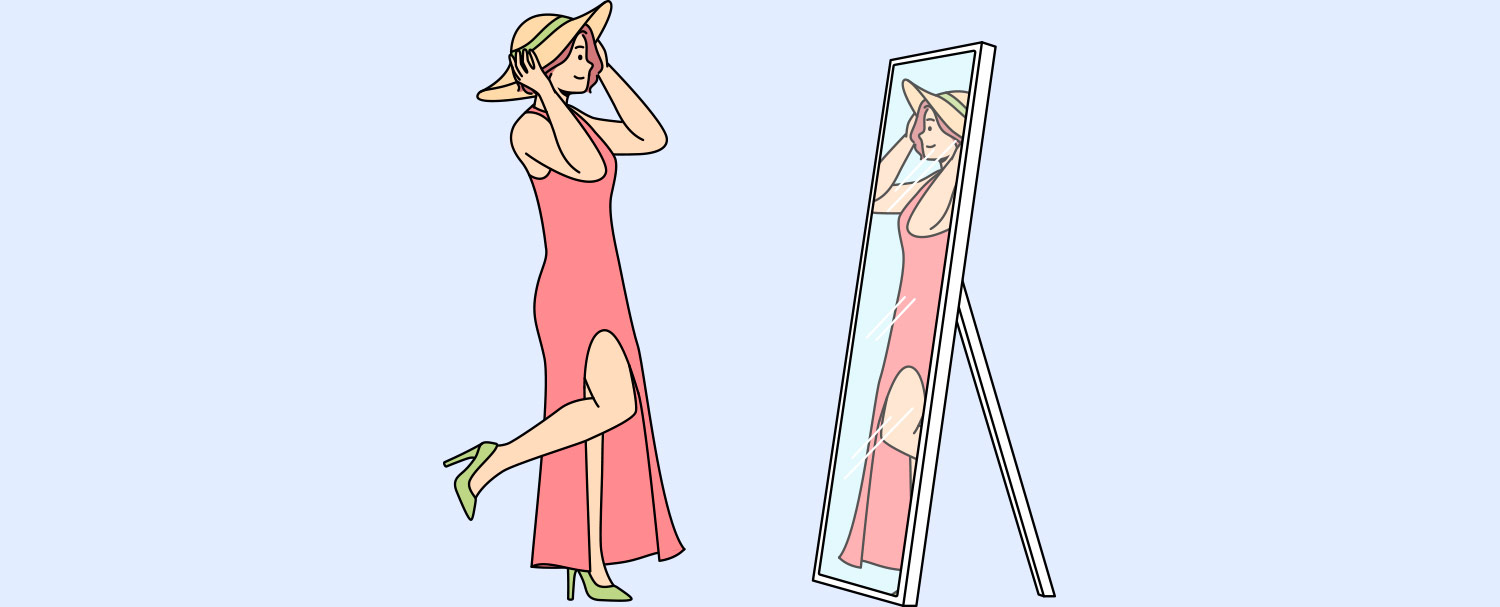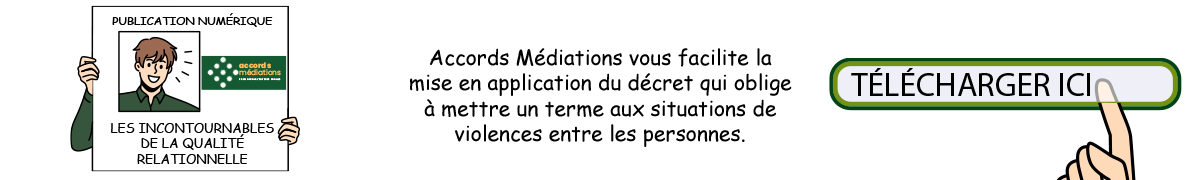de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.
Reprendre le sport, s’initier à la poterie, s’inscrire à une formation, lancer ce projet qui dort depuis trop longtemps, apprendre à lâcher prise, s’engager dans une association, fréquenter assidûment les rayons “développement personnel” des librairies, manger quotidiennement 12 fruits et légumes, faire de la méditation un nouvel art de vivre, etc. : 2022 à peine enterrée, la liste des bonnes résolutions n’en finit plus de s’allonger. Si bien que l’on se demande comment parvenir à toutes les tenir… Le décompte des jours a pourtant déjà commencé pour devenir, enfin, la meilleure version de nous-mêmes…
Mais, encore faudrait-il être capable de mettre précisément le doigt sur la version actuelle de nous-mêmes… Impossible, en effet, d’obtenir cette meilleure version sans connaître concrètement les caractéristiques de ce sujet en demande constante d’amélioration. Impossible de se réaliser sans posséder des données absolues et objectives sur ce “Je” qui semble prendre un malin plaisir à sans cesse se défiler. Et, in fine, nous égarer.
Le piège identitaire
Car, si nous n’arrivons jamais à tenir nos plus ou moins bonnes résolutions, ce n’est pas par manque de volonté. Mais bien plutôt parce que des meilleures versions de nous-mêmes, il n’en n’existe… aucune ! Toutes nos excuses à ceux qui pensaient encore que cette année serait vraiment la bonne ! Plus précisément, cette meilleure version est un leurre. En cause ? Son lien inextricable à l’identité, un concept mobilisateur mais pas moins “absolument indéfinissable”, selon la formule d’Edmund Husserl. L’identité représente même un piège redoutable comme le démontre Julia de Funès. Dans son nouvel ouvrage1, la philosophe pointe toutes ces situations où, comme le garçon de café décrit par Jean-Paul Sartre, nous jouons à être et, ce faisant, ne vivons qu’à la surface de nous-mêmes. L’identité nous fait prendre de bonnes résolutions. C’est à cause d’elle aussi que nous endossons des rôles et des postures qui nous formatent et nous éloignent de nous-mêmes. À ce “vol de soi”, s’ajoutent les crispations identitaires qui, à l’échelle collective, s’alimentent “au point de faire des moindres différences des mini-impérialismes, jusqu’à ébranler l’universalisme républicain1”. Enfin, conceptuellement, l’identité se révèle inopérante. Et ce, peu importe que nous l’associions à l’idée d’enracinement, à la culture, au corps, à l’esprit ou à une forme d’authenticité.
🚀 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.
Je m'inscris !Cette impuissance “est d’abord liée à la permanence que l’identité suppose1”. Chercher une identité revient en effet à chercher ce qui demeure, ce qui reste identique. Autrement dit, le même. Or, le nourrisson que j’ai été est à mille lieues de l’adulte que je suis devenue. Il en va de même pour l’ado qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie et le professionnel que vous êtes aujourd’hui. Entre les uns et les autres, “aucune identité numérique (identification parfaite) ni aucune identité qualitative (substitution) ne sont possibles1”. C’est là qu’entre en jeu l’idée de permanence. Elle seule peut “nous faire croire à l’identité, à la continuité ininterrompue d’un pays, d’un lieu, d’un être1”. Le problème ? Se raccrocher à la permanence comme une bouée de sauvetage revient ni plus ni moins “à nier la vie qui n’a de permanent que son impermanence1”. Peu importe qui nous sommes, nous sommes tous soumis à la temporalité et donc jamais identiques à nous-mêmes…
La reconnaissance de qui nous sommes
N’allez pas croire pour autant que nous n’avons d’autre choix que de nous penser “désencombrés” de toute appartenance. Ma couleur de peau diffère peut-être de la vôtre. Nous partageons sans doute la même nationalité. À moins que ce ne soit le genre, l’âge, le métier ou la sexualité. Mais nous ne saurions être réduits à ces tentatives vaines de généralisation. “Jamais aucune de ces catégories n’atteindra ma singularité” pas plus que la vôtre puisqu’elles sont par définition singulières. C’est pourquoi Hannah Arendt nous invitait, bien avant que “communauté” ne devienne un gros mot, à distinguer “ce que l’on est” et “qui l’on est”. Ce que l’on est est directement visible. Ce sont les qualités et les défauts que l’on peut choisir “d’étaler ou de dissimuler” et qui sont “implicites dans tout ce que l’on fait et tout ce que l’on dit2”. Le “qui”, en revanche, ne se résume pas à la somme de nos talents ou de nos traits de caractère. Il semble devoir toujours nous échapper.
Fière de n’avoir jamais appartenu à un “-isme”, Arendt savait mieux que nulle autre combien révéler volontairement qui nous sommes est, sinon impossible, du moins difficile. Comment imaginer, en effet, pouvoir posséder ce “qui” et “en disposer de la même manière que l’on a des qualités et que l’on en dispose2”. Mais si nous sommes largement aveugles à nous-mêmes, autrui, lui, peut nous saisir plus facilement et nous permettre de mieux nous comprendre. Encore faut-il que cet autre nous reconnaisse. Une mission à haut risque quand la susceptibilité est exacerbée au point de transformer toute offense en préjudice et toute discussion en “affront identitaire”.
Le sentiment de soi
Pourtant, Julia de Funès en est convaincue, l’harmonie sociale ne peut se dispenser d’une reconnaissance mutuelle. Or, reconnaître quelqu’un suppose de reconnaître un sujet, une personne, une autonomie, une liberté. Seule cette dernière engendre la reconnaissance. Aussi, la distinguer de la gangue identitaire constitue pour la philosophe le prix de l’apaisement. Elle nous invite également à distinguer l’obsession identitaire du “sentiment de soi” qui, plutôt que de nous figer, “épouse le mouvement de la vie1”. Savoir être soi, “la plus grande chose du monde3” selon Montaigne, ne revient pas à se replier sur soi-même. Au contraire, c’est un appel à l’ouverture. À l’autre sans jamais s’oublier.
Car, “être à soi n’empêche pas de s’engager, mais interdit de se sentir prisonnier. Être à soi n’empêche pas de jouer un rôle, mais à condition de ne pas s’y enfermer1”. Être à soi n’empêche pas de rendre visite à d’autres points de vue mais à condition de ne pas remplacer ses propres prêts d’intention par les préjugés d’autres personnes. En somme, être à soi nous encourage à élargir notre pensée et, avec elle, notre mentalité. Ni opinion majoritaire (l’élargissement ne vise pas l’unanimité mais la pluralité des perspectives), ni empathie (la considération d’autres points de vue n’implique pas leur adoption), la mentalité élargie permet, comme l’écrit si joliment Arendt “d’être et de penser dans ma propre identité où je ne suis pas réellement4”. Elle engage un processus de compréhension du monde qui suppose de convier une multiplicité de perspectives sur le monde, de rendre présent ce qui est absent. L’imagination devient alors un outil précieux de médiation. Car “frotter son entendement à celui des autres, repousser les limites de son propre point de vue, est le meilleur moyen de gagner en objectivité, en justice et en justesse1”. Tentons alors, en guise de bonne résolution pour cette nouvelle année, de faire des classements identitaires fossilisants “non des buts mais des emprunts, non des armures mais des habits, non des acquis mais des prêts1”. Ne serait-ce que pour nous souhaiter de meilleures relations mais, surtout, davantage de liberté !
Marianne Fougère
Plume vagabonde et indépendante
1 Julia de Funès, Le siècle des égarés, Paris : Éditions de L’Observatoire, coll. Hors collection, 2022.
2 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne in L’Humaine condition, Paris : Gallimard, coll. Quarto, 2012, p. 203-204.
3 Michel de Montaigne, Essais, Livre 1, Paris : Garnier-Flammarion, 2011.
4 Hannah Arendt, “Vérité et Politique” in L’Humaine Condition, op. cit., p. 801.