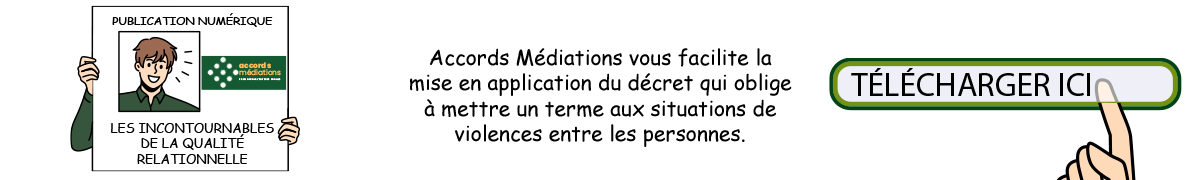de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.
Formulée déclinée à l’envie par les ouvrages de développement personnel, nous est-il réellement permis d’espérer un jour réussir à écrire nos vies ?
Chez Accords Médiations, vous l’aurez compris, on est très friand d’histoires et encore plus quand elles sont parvenues à traverser les siècles. En témoigne, notre passion sans borne ni faille pour Antigone. Sur ce site, les références à l’héroïne la plus célèbre de la littérature antique se multiplient. Si bien que l’on réfléchit à la possibilité de lui créer un filtre dédié pour faciliter la navigation de nos lecteurs !
Et si l’on aime tant l’œuvre de Sophocle, ce n’est pas que pour les beaux yeux d’Antigone. Mais, plus trivialement, parce qu’avec la tragédie, on est bien tranquille. Avec la tragédie, pas de suspense ni de retournement de situation. C’est propre, c’est sûr, c’est même, comme l’écrivait Jean Anouilh, à propos de sa réécriture de la tragédie de Sophocle, “reposant”. Pourquoi ? Tout simplement, “parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le sale espoir ; qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos – et qu’on n’a plus qu’à crier, – pas à gémir, non, pas à se plaindre – mais à gueuler à pleine voix ce qu’on avait à dire, qu’on n’avait jamais dit*”. Même pas à notre psy ou à notre thérapeute. D’ailleurs, avec la tragédie, adieu coachs et autres sages du wellness. La fatalité à l’œuvre dans le texte nous décharge du fardeau d’avoir à être, à nous définir, à nous redéfinir, à nous accomplir. Bref, à être l’auteur de notre vie.
🚀 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.
Je m'inscris !Forces occultes
Mais si les mantras qui pullulent sur les réseaux sociaux ou les livres qui fleurissent sur les étagères de nos librairies entretiennent un discours pour le moins culpabilisant, est-il préférable de se contenter, comme l’Antigone de Sophocle ou d’Anouilh, d’être non pas l’autrice mais l’actrice de sa vie ? C’est tout du moins un peu frustrant, voire carrément flippant, de s’imaginer joujou livré entre les mains du destin. C’est peu réconfortant, voire carrément déprimant, de s’entendre dire par les stoïciens, d’aimer ce qui nous arrive puisque, de toute façon, tout est déjà préparé d’avance…
Après tout, dans sa version d’Antigone, Anouilh aurait pu choisir de ne pas laisser mourir son héroïne. Antigone aurait pu ne pas se suicider avec sa ceinture. La fille d’Œdipe aurait même pu ne pas se soulever contre l’ordre de son oncle Créon. D’ailleurs, comme l’observe fort justement Marianne Chaillan, “le conditionnel passé n’est-il pas ce temps qui nous dévoile à la fois nos possibles et notre responsabilité dans ce que nous aurons choisi d’écrire ou de laisser sombrer dans le néant ?**” Manière de rappeler, que derrière chaque décision que nous prenons se cache toute une forêt de possibilités alternatives. Les choix que nous faisons actualisent certaines d’entre elles et laissent les autres bien enracinées dans le champ des possibles qui n’auront jamais lieu.
Les chemins de la liberté
Mais, n’en déplaise à Descartes qui estime que la liberté consiste à faire une chose ou à ne pas la faire, certaines possibilités nous sont impossibles voire interdites. Comme enfoncer la porte de son palais pour entrer de plein pied dans l’espace public et ce, alors même que l’on est une femme dans l’Antiquité… Des siècles plus tard, les choses n’ont pas tellement changé. Suicide, mariage ou divorce, maternité, sexualité ou passions : chacune de nos décisions, y compris les plus individuelles, sont marquées du sceau de l’injonction sociale. En théorie, nous sommes sacrément libres mais en pratique c’est une tout autre histoire. Notre liberté est presque toujours annihilée par “la dictature insidieuse du On**”. Avec le risque de ne plus être maître dans notre propre maison. De ne plus être libre d’être nous-mêmes.
À moins peut-être que nous décidions de reconsidérer notre définition de la liberté ? Dans son essai Écrire sa vie, Marianne Chaillan propose justement de nous débarrasser du concept spécieux du libre arbitre. Ou, dit autrement, d’en finir avec les “Quand on veut, on peut”. Car ce n’est pas vrai : nous sommes toutes et tous pris de façon indépassable dans la force des choses. Ce qui ne fait pas pour autant de nous des êtres serviles. La liberté nous est permise à condition de la concevoir comme “un processus, une dynamique au cœur même de la servitude et de la nécessité**”. Une compréhension fine de la nécessité nous offre, en effet, la possibilité de ne pas donner prise à nos affects, de les dépassionner et donc, in fine, de moins en pâtir, de passer d’une position de passivité à une position d’activité. “Et c’est précisément dans cette activité que consiste la liberté**” et un peu aussi dans les manières que nous choisirons de raconter nos vies. “À nous [donc] d’écrire nos mille et une nuits, sans illusion sur notre capacité à en décider absolument le contenu ni à en maîtriser l’issue, mais en nous souhaitant une force et une vitalité telles que nous ayons toujours envie d’entendre et d’écrire la suite**”.
Marianne FOUGÈRE
Plume indépendante et vagabonde
* Jean Anouilh, Antigone, Paris, Éditions de la Table ronde, 2016.
** Marianne Chaillan, Écrire sa vie, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2024.