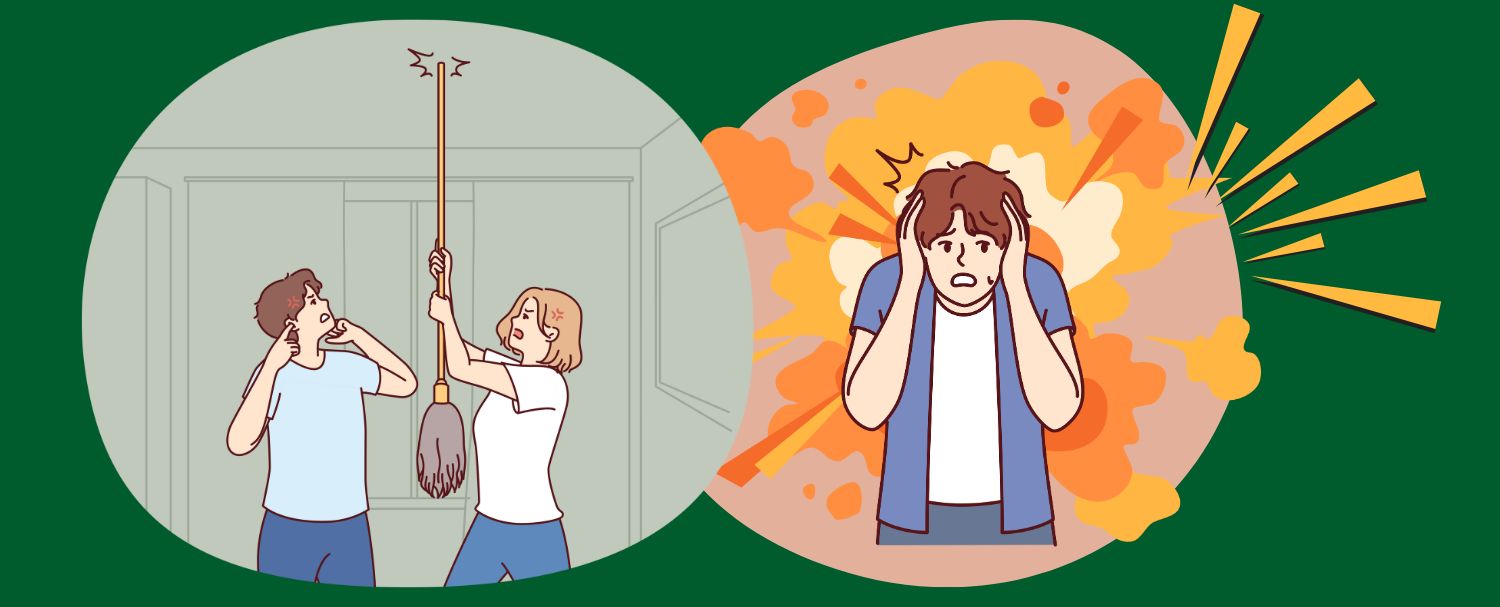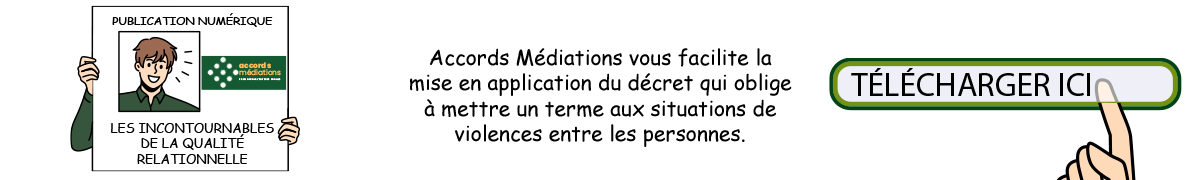de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.
Si l’affaire peut prêter à sourire et résonne avec l’actualité cinématographique – courrez voir l’absurde Procès du chien de Laetitia Dosch ! – on oublie qu’elle a eu un retentissement au-delà des seules côtes charentaises. Depuis, la loi du 29 janvier 2021, dite “loi Maurice”, vise à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Une loi apparemment impuissante face aux conflits croissants entre néo-ruraux et agriculteurs, puisque le 15 avril dernier, un texte a été adopté pour instaurer un “vivre ensemble” équilibré. Mais une loi peut-elle réellement apaiser les tensions ?
Troubles à l’ordre public
Pour le législateur, elle peut au moins contribuer à limiter les conflits de voisinage. Comment ? En ajoutant au Code civil un nouvel article 1253 qui reprend le principe de responsabilité fondé sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 19 novembre 1986, celle-ci avait établi un principe général selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”.
La loi précise cependant que si votre voisin exerçait son activité agricole avant votre installation, dans les mêmes conditions et dans le respect de la législation, vous ne pourrez pas engager sa responsabilité. Peu importe que cette activité semble excéder les inconvénients ordinaires comme les odeurs de cuisine ou les passages d’aspirateur intempestifs.
🚀 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.
Je m'inscris !Difficile bien-vivre ensemble
Les conflits de voisinage ne se limitent pas aux villes. On pense à ces crêpiers d’Erquy traînés devant la justice par un voisin qui trouvait que leur crêperie sentait trop la crêpe, ou à cette maire confrontée à des cochons errants… Le texte voté par le Parlement concerne aussi bien les zones urbaines que rurales. Néanmoins, il ne prend pas en compte les évolutions dues à la mise aux normes ou à l’agrandissement d’établissements.
Autre limite : la loi laisse les élus démunis face aux colères de leurs administrés. Ils peuvent solliciter la gendarmerie, mais souvent sans grand succès, car il faut une plainte officielle. Même avec une décision de justice, il n’est pas certain qu’elle apaisera les émotions des deux parties.
Émotions : grandes oubliées des conflits de voisinage
Dans le cas des cochons errants, ce n’est pas un juge qui a ordonné leur placement dans un parc, mais la population elle-même. Un agriculteur a fourni une clôture électrique pour éviter les fugues, et la maire, formée par Accords Médiations, a su impliquer la communauté.
Mais tous les élus n’ont pas les compétences pour gérer de telles situations. Pour maintenir de bonnes relations entre voisins, ils doivent apprendre à repérer les risques de dégradation relationnelle. Pourquoi ne pas se former à la qualité relationnelle, faire appel à un médiateur ou mettre en place un service de médiation intercommunal ? Ces solutions sont plus efficaces que les lois pour rétablir la paix.
Marianne FOUGÈRE
Plume indépendante et vagabonde
La formation “Les conflits de voisinage : quand élus rime avec médiation”, en partenariat avec l’Association des Maires de France, a été dispensée dans les départements de l’Indre et du Lot, ainsi qu’à Paris. Accords Médiations animera également un atelier le 19 novembre prochain à 11 heures, Porte de Versailles, lors du Congrès des maires.